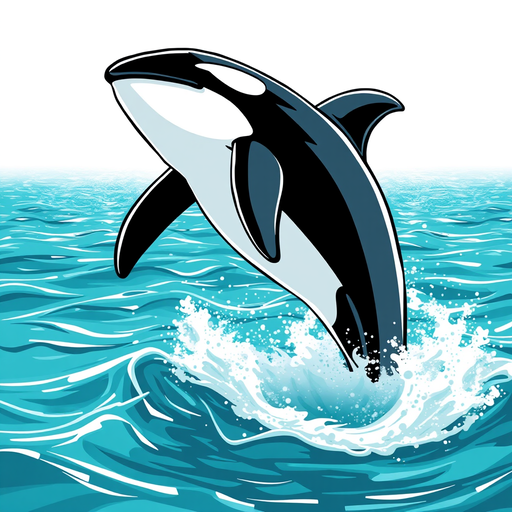Ancienneté et diversité inégalées des requins, preuve d’une réussite évolutive exceptionnelle.
Apparus il y a plus de 400 millions d’années, les requins ont traversé plusieurs extinctions massives sans perdre leur pertinence écologique. On recense aujourd’hui plus de 500 espèces, du géant planctonivore au discret benthique, chacune finement adaptée à sa niche. Cette longévité et cette diversité témoignent d’une stabilité fonctionnelle rare dans le monde animal. C’est la signature d’un design biologique éprouvé par le temps.
Des capteurs et une hydrodynamique de pointe qui en font des prédateurs ultra-efficaces.
Grâce aux ampoules de Lorenzini, un requin perçoit des champs électriques de l’ordre de quelques nanovolts par centimètre, détectant proies et mouvements invisibles. Sa peau à denticules réduit la traînée jusqu’à environ 10% et inspire des technologies de nage et d’anti-encrassement. Porté par cette ingénierie naturelle, le mako peut dépasser 70 km/h en pointe, illustrant l’efficacité énergétique et la vitesse du groupe. Ce cocktail sensoriel et biomécanique maximise la réussite de la chasse pour un coût énergétique minimal.
Régulateurs trophiques, les requins stabilisent les écosystèmes marins.
En contrôlant les méso-prédateurs, ils évitent des cascades écologiques délétères pour récifs, herbiers et pêcheries. Là où certaines grandes espèces de requins ont chuté de 70–90% (Atlantique Nord-Ouest), des explosions de proies ont entraîné l’effondrement des coquilles Saint-Jacques en Caroline du Nord—un cas emblématique de cascade trophique. Leur présence maintient la diversité et la résilience des communautés marines. Protéger les requins, c’est donc renforcer la productivité et la santé des océans.
Un risque humain très faible, mais une valeur écologique et économique élevée.
À l’échelle mondiale, les attaques non provoquées restent rares, avec en moyenne quelques dizaines d’incidents et 5–10 décès par an, tandis que l’humanité prélève des dizaines de millions de requins. L’écotourisme des requins génère plus de 300 millions de dollars par an et incite les communautés côtières à préserver l’habitat. Réhabiliter l’image du requin, c’est investir dans des océans vivants et des économies locales durables. Ce respect éclairé remplace la peur par la connaissance et le bénéfice partagé.